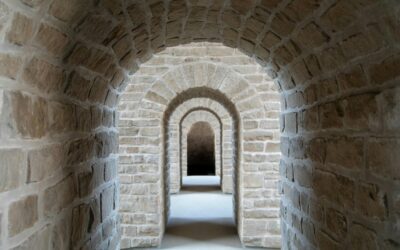L’usufruitier de parts sociales est-il un simple titulaire de droits économiques, ou peut-il s’affirmer comme un véritable acteur du fonctionnement de la société ? La question, longtemps débattue, a connu ces dernières années un net infléchissement jurisprudentiel. Tandis que la chambre commerciale de la Cour de cassation avait rendu un avis retentissant en 2021, c’est désormais la troisième chambre civile qui, dans un arrêt du 11 juillet 2024 (n° 23-10.013), vient consolider cette ligne interprétative. Si l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, il n’en conserve pas moins des droits fondamentaux qui trouvent leur source dans le droit des biens, et dont la mise en œuvre peut s’imposer aux règles statutaires de la société. L’arrêt commenté illustre à merveille la tension persistante entre le droit de jouissance de l’usufruitier, protégé par l’article 578 du Code civil, et les stipulations statutaires qui tendent à restreindre sa capacité d’intervention au sein de la société. Il révèle surtout l’incursion nécessaire du droit de propriété dans les mécanismes décisionnels collectifs, obligeant les juges à arbitrer entre logique patrimoniale et autonomie statutaire.
L’affaire : entre abus de majorité et exclusion statutaire de l’usufruitier
Les faits sont révélateurs des enjeux contemporains de gouvernance des sociétés civiles. Dans une SCI, les associés procèdent à une augmentation de capital de grande ampleur (plus de 70.000 parts sociales) et distribuent des dividendes à leurs gérants. Estimant que ces décisions constituent des abus de majorité, plusieurs usufruitiers contestent leur validité en justice. En défense, la société oppose une clause statutaire excluant expressément les usufruitiers de toute action en nullité des décisions collectives, à l’exception de celles portant sur l’affectation des résultats.
La cour d’appel valide cette exclusion et rejette l’action en nullité. La Cour de cassation, saisie par les usufruitiers, annule cette décision en s’appuyant sur un triple fondement : l’article 578 du Code civil, l’article 31 du Code de procédure civile et l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle affirme que si les statuts peuvent légitimement réserver le droit de vote aux seuls associés pour les décisions autres que l’affectation des bénéfices, ils ne sauraient priver l’usufruitier de son droit d’agir en justice lorsqu’une décision sociale compromet directement sa jouissance.
Une solution cohérente : confirmation et extension du droit d’agir de l’usufruitier
Dans un premier temps, l’arrêt confirme avec rigueur une jurisprudence désormais bien assise : l’usufruitier n’est pas associé. Ce rappel est essentiel, car la qualité d’associé conditionne de nombreux droits au sein de la société, en particulier le droit de vote. Toutefois, la Cour de cassation refuse de réduire l’usufruitier à un rôle purement passif. Elle reconnaît que son droit de jouissance – protégé par le droit des biens – peut être affecté par certaines décisions collectives, même s’il ne participe pas directement à leur élaboration.
Cette reconnaissance du droit d’agir en justice constitue une extension significative de ses prérogatives. En ce sens, l’arrêt s’inscrit dans un mouvement plus large de réhabilitation du droit de propriété dans le champ du droit des sociétés, dans lequel le statut juridique des usufruitiers ne saurait être écrasé par la seule logique statutaire.
L’interprétation retenue par la Cour permet donc de faire prévaloir l’équilibre entre la liberté statutaire des sociétés et les droits fondamentaux des co-titulaires de droits sociaux. Elle renforce la sécurité juridique des usufruitiers, souvent tenus à l’écart des décisions stratégiques, en leur ouvrant une voie de recours juridictionnel contre les décisions attentatoires à leur jouissance.
Une insécurité juridique persistante pour les praticiens
Malgré la logique et la cohérence de cette solution, elle n’est pas exempte de critiques. En effet, les statuts des sociétés civiles – et parfois même de sociétés commerciales – sont nombreux à prévoir des clauses limitatives des droits des usufruitiers. Les praticiens se retrouvent dès lors confrontés à une incertitude : quelle est la portée exacte de ces clauses à la lumière de cette jurisprudence ? Quelles décisions collectives sont suffisamment « perturbatrices » pour justifier l’action en nullité de l’usufruitier ? La ligne de démarcation demeure floue.
Plus fondamentalement, cet arrêt soulève une interrogation quant à la nature même du droit de jouissance de l’usufruitier dans le cadre sociétaire. Jusqu’à quel point ce droit doit-il être protégé contre les évolutions du pacte social, souvent guidé par des objectifs économiques et collectifs ? Le juge, en s’immisçant dans les rapports sociaux pour garantir les droits du nu-propriétaire et de l’usufruitier, redéfinit-il subrepticement le champ de la liberté contractuelle au sein de la société ?
Ces interrogations révèlent un risque de contentieux croissant, notamment dans les structures familiales où les démembrements de propriété sont fréquents. L’enjeu n’est pas seulement théorique : il conditionne la stabilité des décisions collectives et la lisibilité du fonctionnement statutaire.
Conclusion
L’arrêt du 11 juillet 2024 illustre la complexité croissante du droit des sociétés contemporain, au carrefour du droit des biens, de la procédure civile et des droits fondamentaux. En affirmant que l’usufruitier de parts sociales, bien que non associé, peut contester les décisions collectives portant atteinte à sa jouissance, la Cour de cassation trace une ligne de crête entre protection du patrimoine individuel et liberté statutaire. La solution est équilibrée, mais elle impose aux praticiens une vigilance renouvelée dans la rédaction des statuts, qui ne peuvent plus prétendre neutraliser les droits de l’usufruitier au nom d’une autonomie sociétaire absolue.
Cet arrêt s’inscrit dans une tendance plus large d’interconnexion des branches du droit : le droit des sociétés ne saurait s’affranchir des exigences du droit de propriété ni de l’accès au juge. En cela, il engage une réflexion essentielle sur la place de l’individu dans les structures collectives et sur les nouvelles frontières de l’affectio societatis.