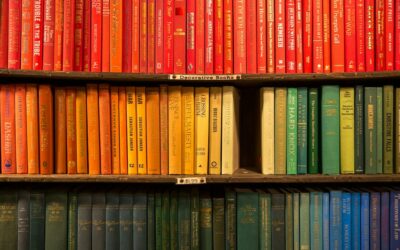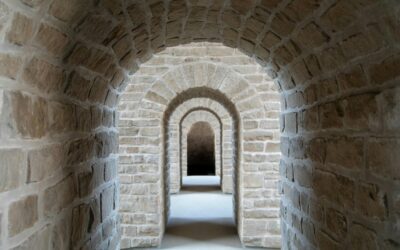La donation de droits sociaux, si elle répond à une volonté de transmission anticipée du patrimoine, n’échappe pas à la réalité dynamique de la vie sociétaire. En effet, les parts ou actions ainsi transmises peuvent, entre la date de la donation et le décès du donateur ou du donataire, connaître de nombreuses modifications : transformation de la société, fusions, augmentations ou réductions de capital, voire dissolution. Ces évolutions soulèvent des difficultés juridiques redoutables lorsqu’il s’agit de faire jouer une clause de retour conventionnel, d’exécuter une libéralité résiduelle ou graduelle, ou encore de reconstituer fictivement une masse successorale en vue d’une réduction ou d’un rapport. L’enjeu est alors double : déterminer quels droits subsistent dans le patrimoine du donataire au moment de son décès, et définir les contours exacts de la réunion fictive et du rapport à la succession du donateur.
La succession du donataire : la clause de retour à l’épreuve des transformations
Lorsqu’un donataire décède, il n’est pas rare que la question de la réversibilité des biens donnés soit posée. Le droit de retour conventionnel prévu à l’article 951 du Code civil permet au donateur de récupérer les biens donnés, sous condition de prédécès du donataire, et parfois de ses descendants. Ce mécanisme, qualifié par la jurisprudence de condition résolutoire, produit un effet rétroactif : il est censé remettre les parties dans l’état antérieur à la donation. Le problème surgit toutefois lorsque les droits sociaux donnés n’ont pas survécu dans leur forme initiale.
Trois hypothèses peuvent être distinguées. Dans un premier cas, les droits sociaux existent toujours mais ont subi des transformations (changement de forme sociale, conversion en actions de préférence, variation de nominal). Dans ce cas, le droit de retour joue pleinement, le bien étant considéré comme subsistant. Dans un second cas, les droits sociaux ont donné lieu à l’émission de nouveaux titres (par exemple, attribution gratuite issue d’une augmentation de capital par incorporation de réserves). La jurisprudence tend à considérer ces accroissements comme compris dans le droit de retour, sauf s’ils constituent des fruits, tels les dividendes. Enfin, dans un troisième cas, les titres ont été échangés, notamment dans le cadre d’une fusion-absorption. La question d’une éventuelle subrogation réelle se pose alors. Si aucune solution ne s’impose avec évidence, une analogie avec les régimes matrimoniaux conduit à admettre que les nouveaux titres entrent dans l’assiette du droit de retour, à condition que le lien de causalité soit direct avec les titres initiaux.
Quant aux libéralités graduelles ou résiduelles, leur régime est plus subtil. Le second gratifié ne peut recevoir que les biens subsistants en nature au décès du premier gratifié. Toutefois, l’article 1049 du Code civil prévoit une exception en cas de subrogation au sein d’un portefeuille de valeurs mobilières. Une lecture extensive permettrait d’inclure les titres reçus par voie de fusion, mais une telle interprétation est encore discutée. Reste la possibilité d’insérer une clause de subrogation explicite dans l’acte de donation, pratique validée par la jurisprudence pour les legs de residuo, et souhaitable pour sécuriser les transmissions complexes.
La succession du donateur : réunion fictive et rapport des donations transformées
La seconde étape de l’analyse concerne la succession du donateur. Deux mécanismes essentiels du droit successoral sont ici mobilisés : la réunion fictive, destinée à vérifier le respect de la réserve héréditaire, et le rapport, qui vise à assurer l’égalité entre héritiers lorsque la donation a été consentie en avancement de part.
Pour la réunion fictive, l’article 922 du Code civil précise que les biens donnés doivent être réintégrés dans la masse successorale fictive « d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur au jour de l’ouverture de la succession ». Cette formule ambiguë doit être maniée avec précaution. En effet, si le bien donné a changé d’état indépendamment de la volonté du donataire, ce changement doit être pris en compte. Ainsi, une transformation sociale, une fusion, ou même une conversion en parts différentes ne font pas obstacle à la réunion. Le droit à la réserve doit donc pouvoir s’appliquer sur les droits sociaux résultant de ces évolutions.
Concernant le rapport prévu par l’article 860 du Code civil, le raisonnement est analogue. La valeur du bien donné est appréciée au jour du partage, mais en fonction de son état à l’époque de la donation, sauf si cet état a évolué indépendamment du comportement du gratifié. L’objectif est d’éviter que le donataire ne manipule volontairement l’évolution des titres pour réduire artificiellement la valeur de ce qu’il doit rapporter. L’appréciation de la volonté du donataire devient ainsi déterminante. Si une augmentation de capital a été décidée sans que le donataire y ait contribué activement, les titres reçus à ce titre pourraient être exclus du rapport. En revanche, s’il en est l’instigateur, leur prise en compte s’imposera.
Enfin, tant pour la réunion fictive que pour le rapport, la subrogation réelle est expressément prévue, notamment en cas d’échange de titres dans le cadre d’une fusion. La jurisprudence reconnaît ainsi la nécessité d’une approche pragmatique, qui tienne compte de la continuité économique et patrimoniale des droits sociaux, sans s’arrêter à leur seule désignation formelle.
Conclusion
L’évolution des droits sociaux après une donation pose des questions complexes qui appellent des réponses nuancées, à la croisée du droit des sociétés, du droit des successions et du droit des libéralités. En présence d’une clause de retour ou d’une libéralité résiduelle ou graduelle, c’est l’analyse de la continuité du patrimoine transmis qui prime. Du côté du donateur, c’est l’équité du partage successoral qui est en jeu, à travers les mécanismes du rapport et de la réduction.
La solution, pour les praticiens, réside dans l’anticipation. Il est impératif de sécuriser les actes de donation en y insérant des clauses précises sur les effets des transformations, en particulier par la stipulation de subrogation réelle. Par ailleurs, le dialogue entre le droit des successions et le droit des sociétés ne saurait être ignoré. Il impose une relecture constante des actes de libéralité à la lumière de l’évolution économique des sociétés, afin de préserver à la fois l’intention du donateur, les droits du gratifié, et l’équilibre de la succession.