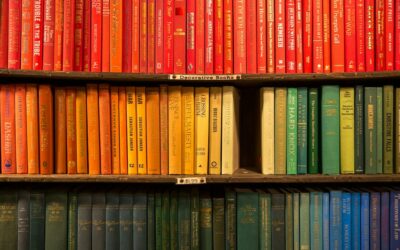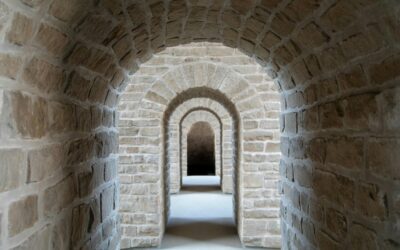Par deux arrêts rendus à l’automne 2024, la Cour de cassation consacre une nouvelle approche jurisprudentielle de la reprise d’actes conclus avant l’immatriculation d’une société. Loin d’être un simple ajustement technique, ce revirement marque une inflexion notable dans la manière dont le droit des sociétés appréhende la formation progressive de la personnalité morale. Une avancée en apparence favorable aux créateurs d’entreprise… mais non dénuée de risques.`
Une période de formation désormais mieux encadrée ?
La période qui précède l’immatriculation d’une société est une zone grise, à la fois sur le plan juridique et économique. C’est là que tout commence, mais aussi que tout peut vaciller. Les porteurs de projets y multiplient les démarches : réservation d’un local, signature d’un devis, sollicitation de partenaires… Pourtant, à ce stade, la société n’existe pas encore juridiquement. Elle ne peut donc ni contracter ni engager de responsabilité. Ce sont alors les fondateurs qui se substituent à elle, à leurs risques et périls.
La reprise d’actes, une fois la société immatriculée, permet d’assurer une continuité juridique entre les engagements pris « en son nom » et l’existence propre de la personne morale. Jusqu’à présent, la Cour de cassation se montrait rigoureuse : pour qu’un acte passé avant immatriculation soit valablement repris, encore fallait-il qu’il mentionne expressément qu’il avait été conclu pour le compte de la société en formation.
Le nouveau principe, dégagé dans un arrêt de principe du 29 novembre 2023 et appliqué en octobre 2024, renverse cette exigence formelle. Désormais, il appartient au juge d’interpréter l’intention des parties à la lumière de l’ensemble des circonstances, y compris extrinsèques à l’acte. L’acte n’a donc plus besoin de mentionner qu’il est conclu au nom de la société à naître – à condition que le juge y décèle une volonté commune allant en ce sens.
Un assouplissement bienvenu, mais porteur d’insécurité juridique
Ce changement de cap répond incontestablement à un besoin pratique. Il n’est pas rare qu’un fondateur, souvent peu rompu aux subtilités juridiques, omette de mentionner la qualité exacte de la société en formation dans les premiers actes. Un devis signé à la hâte, un bon de commande lancé pour saisir une opportunité commerciale, et voilà que l’on engage personnellement sa responsabilité sans l’avoir voulu. En ce sens, la nouvelle jurisprudence vise à ne pas sacrifier la substance à la forme : si, de fait, tout le monde a agi comme si la société existait, pourquoi ne pas le reconnaître juridiquement ?
Mais cette souplesse, si elle se comprend dans une logique économique, n’est pas sans fragiliser la sécurité juridique. Car substituer à une condition de forme – la mention claire du contrat pour le compte de la société en formation – une appréciation fondée sur l’intention des parties revient à déplacer la frontière entre le droit et le fait. Le juge devient alors l’arbitre ultime de ce que les parties ont voulu, au risque de donner naissance à une jurisprudence fluctuante, au gré des interprétations subjectives.
L’intention des parties, notion centrale du droit des contrats, devient ici une clé de voûte incertaine, dont la preuve peut s’avérer délicate, voire impossible, plusieurs mois ou années après la signature d’un acte.
Un risque contentieux accru pour les partenaires contractuels
Si cette jurisprudence peut protéger le fondateur contre une responsabilité involontaire, elle interroge quant à la protection du cocontractant. Que devient en effet la sécurité des relations contractuelles lorsque la nature juridique d’un acte peut être réinterprétée a posteriori par le juge ? Une entreprise signant un contrat avec un porteur de projet non immatriculé peut-elle encore être certaine de l’identité de son cocontractant ? Et si la société ne voit finalement pas le jour, ou se désolidarise de l’engagement initial, quelle certitude demeure pour le prestataire ou le vendeur ?
Dans les deux affaires jugées en octobre 2024, la Cour casse les décisions de fond justement parce que les juges du fond n’ont pas caractérisé l’intention commune des deux parties de conclure l’acte pour le compte de la société. Cette exigence de concordance des volontés – somme toute logique – ajoute toutefois un niveau d’incertitude : la volonté de la société seule ne suffit pas ; il faut prouver que le cocontractant la partageait. Et cette preuve se construit à partir de bribes : correspondances, circonstances d’exécution, éléments extrinsèques. Autant de pièces qui laissent le champ ouvert à l’interprétation, voire à l’opportunisme judiciaire.
Un flou autour de la personnalité morale en devenir
Cette évolution jurisprudentielle traduit en creux une transformation profonde de la conception de la personnalité morale en droit français. La société n’est juridiquement dotée de la personnalité que le jour de son immatriculation – mais la jurisprudence semble désormais entériner l’idée qu’elle pourrait agir, par l’intermédiaire de ses fondateurs, avant même d’exister.
On entre ici dans une logique de personnalité morale anticipée, ou du moins présumée, dès lors que l’intention de ses promoteurs est claire. Une telle tendance, si elle se prolonge, pourrait brouiller les frontières entre personne physique et personne morale. Car si la société peut être engagée rétroactivement sur des actes passés sans mandat formel, à quel moment cesse-t-on d’agir à titre personnel pour commencer à engager une entité qui n’existe pas encore ?
Le droit, en s’adaptant aux nécessités économiques, semble ici flirter avec la fiction juridique la plus incertaine : celle d’un sujet de droit en gestation, auquel on reconnaîtrait des effets juridiques sans existence propre.
Vers une contractualisation préventive renforcée ?
Dans ce contexte, les conseils aux entrepreneurs doivent évoluer. Là où auparavant, une simple mention dans le contrat suffisait à sécuriser juridiquement l’engagement, il faut désormais aller plus loin dans la traçabilité de l’intention commune. L’annexe aux statuts, la signature d’un mandat, voire une lettre d’engagement préalable deviennent des outils non seulement recommandables, mais indispensables pour limiter les aléas de l’interprétation judiciaire.
De même, les cocontractants (fournisseurs, prestataires, bailleurs) doivent redoubler de vigilance. Lorsqu’ils signent un acte avec un porteur de projet non encore immatriculé, il est de leur intérêt de faire préciser clairement l’identité de la partie engagée. À défaut, ils pourraient se retrouver à devoir négocier, ou contester, la validité d’un engagement longtemps après la signature.
Conclusion : prudence et méthode face à une jurisprudence en mutation
La jurisprudence récente de la Cour de cassation consacre une forme d’ajustement réaliste du droit des sociétés, en reconnaissant que les fondateurs n’attendent pas l’immatriculation pour agir. Cette reconnaissance est salutaire. Mais elle s’accompagne d’une redéfinition du cadre juridique, où la clarté contractuelle recule au profit d’une appréciation judiciaire toujours plus centrale.
Pour les créateurs d’entreprise, l’enjeu est clair : ne pas confondre souplesse et insouciance. Si le droit admet désormais que des actes imprécis peuvent être repris, il n’en reste pas moins que le flou juridique reste toujours un facteur de contentieux et d’instabilité.
Le bon réflexe ? Sécuriser chaque engagement, formaliser chaque intention, et s’entourer des conseils nécessaires pour traverser sereinement la phase fondatrice.